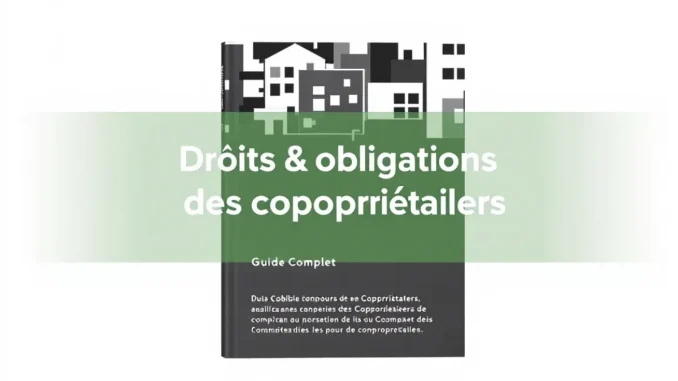
La copropriété constitue un régime juridique particulier où plusieurs personnes possèdent ensemble un même immeuble, tout en disposant de droits privatifs sur certaines parties. Ce statut, régi principalement par la loi du 10 juillet 1965 et ses nombreuses modifications, crée un équilibre délicat entre droits individuels et vie collective. Naviguer dans cet environnement juridique complexe représente un défi pour les 10 millions de Français vivant en copropriété. Entre prérogatives personnelles et contraintes communes, les copropriétaires doivent maîtriser leurs droits tout en respectant leurs obligations, sous peine de sanctions ou de tensions au sein de la communauté. Ce guide détaille l’ensemble des aspects juridiques essentiels pour tout copropriétaire, qu’il soit novice ou expérimenté.
Fondements juridiques de la copropriété en France
Le régime de la copropriété en France repose sur un cadre législatif et réglementaire précis, dont la pierre angulaire demeure la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Ce texte fondateur, complété par le décret du 17 mars 1967, établit les principes directeurs qui régissent les rapports entre copropriétaires. Au fil des années, de nombreuses réformes ont modernisé ce dispositif, notamment la loi ALUR de 2014, la loi ELAN de 2018 et plus récemment la loi du 31 octobre 2022 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne.
La copropriété se définit juridiquement comme un immeuble ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots. Chaque lot comprend une partie privative et une quote-part des parties communes, exprimée en tantièmes ou millièmes. Cette division particulière de la propriété entraîne une organisation juridique spécifique.
Le règlement de copropriété constitue la « constitution » de chaque copropriété. Document contractuel obligatoire, il détermine la destination des parties privatives et communes, fixe les règles de fonctionnement et définit les droits et obligations des copropriétaires. Il s’accompagne de l’état descriptif de division, document technique qui identifie précisément chaque lot et sa quote-part de parties communes.
La distinction fondamentale : parties privatives et communes
La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours de cette distinction fondamentale. Les parties privatives sont celles réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles comprennent typiquement l’intérieur des appartements, les caves ou places de parking attribuées. Les parties communes sont celles affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires : gros œuvre, toiture, façades, escaliers, ascenseurs, locaux techniques, etc.
Cette distinction n’est pas toujours évidente, comme l’illustrent les nombreux contentieux concernant les fenêtres, balcons ou canalisations. Ainsi, un arrêt de la 3ème chambre civile du 30 janvier 2020 a rappelé que les fenêtres, bien que situées dans les parties privatives, constituent des parties communes en raison de leur impact sur l’aspect extérieur de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires, personne morale regroupant l’ensemble des copropriétaires, veille au respect des règles collectives et à la conservation de l’immeuble. Il s’exprime à travers l’assemblée générale, organe souverain, et agit par l’intermédiaire du syndic, mandataire légal chargé d’exécuter ses décisions.
Ce cadre juridique vise à concilier deux principes parfois contradictoires : le respect du droit de propriété individuel et la nécessaire solidarité entre membres d’une même copropriété. Cette tension permanente explique la richesse du contentieux en la matière et les évolutions législatives régulières qui tentent d’adapter ce régime aux réalités contemporaines.
Droits fondamentaux des copropriétaires
Chaque copropriétaire bénéficie d’un ensemble de prérogatives juridiques garanties par la loi. Ces droits, qui constituent le socle de leur statut, s’exercent tant sur les parties privatives que dans la gouvernance collective de l’immeuble.
Droits sur les parties privatives
Le droit de jouissance exclusif représente la prérogative la plus emblématique du copropriétaire sur son lot. L’article 9 de la loi de 1965 consacre le principe selon lequel chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et en use librement, à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Ce droit se traduit concrètement par la possibilité d’aménager son logement selon ses souhaits, d’y réaliser des travaux d’amélioration ou de modification, sous réserve des limitations imposées par le règlement de copropriété ou la destination de l’immeuble. Par exemple, un arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2019 a confirmé qu’un copropriétaire pouvait librement modifier la disposition intérieure de son appartement, y compris en déplaçant des cloisons non porteuses, sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Le droit de louer son bien constitue une autre prérogative majeure. Le copropriétaire peut librement mettre en location son lot, que ce soit en bail d’habitation classique, en meublé touristique (sous réserve des réglementations locales) ou en bail commercial si le règlement le permet. Toutefois, la loi ALUR a introduit des obligations d’information du syndic lors de la mise en location.
Le droit de vendre son lot représente une manifestation fondamentale du droit de propriété. Cette prérogative s’exerce sans restriction, hormis l’existence éventuelle d’un droit de préemption au profit de la commune dans certaines zones ou de clauses d’agrément dans des copropriétés très spécifiques (résidences services, par exemple).
Droits de participation à la vie collective
Le droit de vote en assemblée générale constitue le pivot de la participation du copropriétaire à la gouvernance de l’immeuble. Ce droit s’exerce proportionnellement aux tantièmes de copropriété détenus, sauf exceptions prévues par la loi. Il permet d’influer sur toutes les décisions importantes : budget, travaux, choix du syndic, modifications du règlement.
Le droit à l’information garantit au copropriétaire l’accès aux documents essentiels de la copropriété. Il peut ainsi consulter le règlement, les procès-verbaux d’assemblées générales, les contrats souscrits par le syndicat ou les comptes de la copropriété. La loi ELAN a renforcé cette transparence en imposant la mise en place d’un extranet dans les copropriétés de plus de 15 lots.
Le droit de contester les décisions d’assemblée générale offre une garantie juridique fondamentale. Tout copropriétaire peut contester une décision qu’il estime illégale ou abusive devant le tribunal judiciaire, dans un délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal. Cette faculté constitue un contre-pouvoir majeur face au principe majoritaire qui régit les assemblées.
- Droit de jouissance exclusive sur les parties privatives
- Droit de louer ou de vendre son lot
- Droit de vote proportionnel aux tantièmes
- Droit d’accès aux documents de la copropriété
- Droit de contester les décisions d’assemblée générale
Ces droits fondamentaux s’accompagnent toutefois de limites et d’obligations corrélatives, créant ainsi un équilibre subtil entre liberté individuelle et contraintes collectives, caractéristique du régime de copropriété.
Obligations et responsabilités des copropriétaires
La vie en copropriété implique le respect d’un ensemble d’obligations qui constituent le pendant nécessaire des droits précédemment évoqués. Ces devoirs, de nature financière, comportementale ou administrative, garantissent le bon fonctionnement de la collectivité.
Obligations financières
Le paiement des charges de copropriété représente l’obligation financière principale de tout copropriétaire. Ces charges, réparties selon les tantièmes détenus ou selon des clés de répartition spécifiques, se divisent en deux catégories majeures définies par l’article 10 de la loi de 1965.
Les charges générales concernent la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes. Elles incluent notamment les frais de nettoyage, d’éclairage, d’assurance de l’immeuble ou les honoraires du syndic. Leur répartition s’effectue proportionnellement aux quotes-parts de parties communes détenues par chaque copropriétaire.
Les charges spéciales correspondent aux services collectifs et éléments d’équipement commun. Elles comprennent par exemple les frais d’ascenseur, de chauffage collectif ou d’interphone. Leur répartition tient compte de l’utilité objective que ces services présentent pour chaque lot. Ainsi, un copropriétaire du rez-de-chaussée peut être exonéré des charges d’ascenseur.
Le défaut de paiement des charges entraîne des conséquences juridiques graves. Après mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours, le syndic peut engager une procédure de recouvrement pouvant aboutir à une saisie immobilière et à la vente forcée du lot. La jurisprudence considère que cette obligation de paiement est d’ordre public et qu’aucun copropriétaire ne peut s’y soustraire, même en cas de contestation sur le montant ou la répartition des charges.
La contribution aux travaux votés en assemblée générale constitue une autre obligation financière majeure. Selon la nature des travaux (entretien courant, amélioration ou travaux d’urgence), différentes majorités sont requises, mais une fois la décision prise régulièrement, tous les copropriétaires doivent y participer financièrement, même ceux qui s’y sont opposés lors du vote.
Obligations comportementales
Le respect de la destination de l’immeuble fixée par le règlement de copropriété impose des limites à l’usage que chaque copropriétaire peut faire de son lot. Ainsi, dans un immeuble à usage exclusif d’habitation, l’exercice d’une activité professionnelle peut être prohibé. Un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2018 a confirmé la possibilité pour le syndicat d’obtenir la cessation d’une activité commerciale exercée en violation du règlement.
L’obligation de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires se traduit par le respect de règles de voisinage renforcées. Les nuisances sonores, les odeurs ou l’encombrement des parties communes peuvent constituer des troubles anormaux de voisinage engageant la responsabilité de leur auteur.
L’obligation d’entretenir son lot en bon père de famille vise à prévenir tout dommage qui pourrait affecter les parties communes ou les autres lots. Un copropriétaire qui négligerait d’entretenir ses canalisations privatives, causant ainsi une fuite affectant l’appartement du dessous, engagerait sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
- Paiement des charges générales et spéciales
- Contribution aux travaux votés
- Respect de la destination de l’immeuble
- Non-nuisance aux droits des autres copropriétaires
- Entretien diligent de son lot
Ces obligations, dont le non-respect peut entraîner des sanctions allant de l’amende à l’expulsion dans les cas les plus graves, constituent le socle d’une cohabitation harmonieuse au sein de la copropriété. Elles illustrent la dimension collective de ce régime juridique, où l’exercice des droits individuels est nécessairement tempéré par le respect des intérêts communs.
Participation aux assemblées générales : enjeux et stratégies
L’assemblée générale des copropriétaires représente l’instance souveraine de décision au sein de la copropriété. Sa maîtrise constitue un enjeu stratégique pour tout copropriétaire souhaitant défendre efficacement ses intérêts dans la gestion collective de l’immeuble.
Préparation et convocation
La convocation à l’assemblée générale doit être adressée à chaque copropriétaire au moins 21 jours avant la date prévue, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise contre émargement. Ce formalisme strict, imposé par l’article 9 du décret de 1967, vise à garantir l’information effective de tous les copropriétaires.
Le contenu de la convocation est strictement encadré par la loi. Elle doit mentionner le lieu, la date et l’heure de la réunion, l’ordre du jour détaillé, les modalités de consultation des pièces justificatives des charges, ainsi que les projets de résolutions. L’omission d’une de ces mentions peut entraîner la nullité des décisions prises lors de l’assemblée.
La préparation de l’assemblée nécessite une étude approfondie des documents transmis. Un copropriétaire avisé analysera notamment les comptes de l’exercice écoulé, le budget prévisionnel, les contrats soumis au vote et les devis relatifs aux travaux envisagés. Cette phase d’analyse permet d’identifier les points de vigilance et de préparer d’éventuelles questions ou contestations.
La possibilité d’inscrire des questions à l’ordre du jour constitue un droit fondamental du copropriétaire. L’article 10 du décret de 1967 prévoit que tout copropriétaire peut demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour, à condition de notifier sa demande au syndic par lettre recommandée avec accusé de réception avant l’envoi de la convocation.
Participation effective et vote
La participation physique à l’assemblée demeure le moyen le plus efficace d’influencer les décisions. Elle permet d’intervenir dans les débats, de poser des questions au syndic ou aux prestataires présents, et de réagir aux arguments avancés par les autres copropriétaires. Depuis la loi du 23 novembre 2018, la participation à distance par visioconférence est également possible si l’assemblée générale l’a préalablement autorisée.
En cas d’impossibilité d’assister à la réunion, le copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire. Ce mandat, qui doit être écrit, peut être confié à un autre copropriétaire, au conjoint du mandant ou à toute autre personne physique ou morale. Toutefois, l’article 22 de la loi de 1965 limite le nombre de mandats qu’une même personne peut détenir à trois si elle représente plus de 10% des voix du syndicat.
Les modalités de vote varient selon la nature des décisions à prendre. L’article 24 de la loi de 1965 prévoit que les décisions courantes (approbation des comptes, budget prévisionnel, petits travaux) sont prises à la majorité simple des copropriétaires présents ou représentés. Les décisions plus importantes (travaux d’amélioration, installation d’équipements nouveaux) requièrent la majorité absolue de tous les copropriétaires (article 25). Enfin, les décisions les plus graves (modification du règlement, aliénation de parties communes) nécessitent une double majorité qualifiée (article 26).
La consignation des votes contre ou des abstentions au procès-verbal revêt une importance particulière. Elle constitue en effet un préalable nécessaire à toute contestation ultérieure d’une décision d’assemblée. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 15 mars 2021, a ainsi rappelé qu’un copropriétaire ayant voté favorablement à une résolution ne peut ultérieurement en demander l’annulation.
Contestation des décisions
Le droit de contester une décision d’assemblée générale s’exerce dans un délai strict de deux mois à compter de la notification du procès-verbal aux absents ou aux opposants. Ce délai, prévu par l’article 42 de la loi de 1965, est un délai préfix dont l’expiration entraîne la forclusion.
Les motifs de contestation sont variés : non-respect des règles de convocation, irrégularité dans le décompte des voix, décision prise à une majorité inadéquate, abus de majorité… La jurisprudence considère toutefois que seules les irrégularités substantielles, ayant pu influencer le sens du vote, justifient l’annulation d’une décision.
La procédure de contestation relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. Elle nécessite le ministère d’avocat et doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic. Des mécanismes alternatifs de règlement des conflits existent néanmoins, comme la médiation ou la conciliation, encouragées par les réformes récentes.
- Analyse préalable des documents de l’assemblée
- Participation en personne ou par mandataire
- Expression claire des votes (pour, contre, abstention)
- Vérification du procès-verbal après l’assemblée
- Contestation dans le délai de deux mois si nécessaire
La maîtrise de ces règles procédurales constitue un atout majeur pour tout copropriétaire souhaitant jouer un rôle actif dans la gouvernance de sa copropriété. Elle permet d’éviter les pièges formels qui invalideraient toute action et d’optimiser son influence sur les décisions collectives.
Résolution des conflits et protection des droits
La vie en copropriété génère inévitablement des tensions et des désaccords, qu’ils concernent les rapports entre copropriétaires ou les relations avec le syndic. Face à ces situations conflictuelles, diverses voies de recours existent, allant des modes alternatifs de règlement des litiges aux procédures judiciaires classiques.
Prévention et gestion amiable des conflits
La prévention constitue la première étape d’une gestion efficace des conflits. Elle passe par une connaissance précise du règlement de copropriété et des résolutions votées en assemblée générale. Un copropriétaire bien informé pourra s’appuyer sur ces documents pour justifier sa position ou contester celle d’un tiers.
En cas de désaccord avec un autre copropriétaire, la démarche amiable directe représente souvent la solution la plus rapide et la moins coûteuse. Une discussion franche, idéalement formalisée par un écrit, permet fréquemment de résoudre des problèmes de voisinage comme les nuisances sonores ou l’occupation indue de parties communes.
Lorsque le dialogue direct s’avère infructueux, l’intervention du conseil syndical peut constituer une première médiation informelle. Composé de copropriétaires élus, cet organe consultatif peut jouer un rôle de conciliateur grâce à sa connaissance des spécificités de l’immeuble et de ses habitants.
La médiation formelle représente une alternative structurée aux procédures judiciaires. Depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation de la justice, une tentative de résolution amiable est même obligatoire avant toute saisine du tribunal pour les litiges inférieurs à 5000 euros. Le médiateur, tiers impartial, aide les parties à trouver elles-mêmes une solution mutuellement acceptable.
La conciliation devant un conciliateur de justice offre une autre voie de résolution amiable. Gratuite et rapide, cette procédure permet d’obtenir un constat d’accord qui, homologué par le juge, acquiert force exécutoire. Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 5 février 2020 a rappelé la valeur juridique de tels accords en matière de copropriété.
Recours contentieux
Lorsque les tentatives amiables échouent, le recours au juge devient nécessaire. Le tribunal judiciaire dispose d’une compétence exclusive pour la plupart des litiges relatifs à la copropriété, qu’il s’agisse de contestation de décisions d’assemblée, de recouvrement de charges ou de travaux non autorisés.
La procédure devant le tribunal judiciaire nécessite la représentation par un avocat, sauf pour certaines procédures simplifiées comme l’injonction de payer. Les délais judiciaires, souvent longs, et les coûts associés (honoraires d’avocat, frais d’expertise) doivent être intégrés dans la stratégie contentieuse.
L’action en justice peut viser différents objectifs selon la nature du litige. Une action en cessation de trouble permettra d’obtenir la fin d’une nuisance (par exemple, l’arrêt d’une activité professionnelle non autorisée). Une action en responsabilité civile visera la réparation d’un préjudice subi (dégât des eaux, par exemple). Une action en nullité ciblera l’annulation d’une décision d’assemblée irrégulière.
La preuve joue un rôle déterminant dans ces procédures. Le copropriétaire vigilant conservera tous les documents utiles (correspondances, procès-verbaux, photographies, constats d’huissier) susceptibles d’étayer sa position. Une expertise judiciaire peut également être ordonnée pour établir des faits techniques complexes.
Protections spécifiques
Le législateur a instauré des protections particulières pour certaines situations. Ainsi, l’article 15 de la loi de 1965 prévoit que tout copropriétaire peut faire opposition au paiement du prix de vente d’un lot entre les mains du notaire lorsque le vendeur est débiteur de charges de copropriété.
La prescription biennale prévue par l’article 42 de la même loi protège les copropriétaires contre les actions tardives. Les actions personnelles entre copropriétaires ou entre copropriétaires et syndicat se prescrivent par dix ans, mais les actions en paiement de charges se prescrivent par cinq ans.
Le droit de la copropriété prévoit également des sanctions spécifiques contre les abus. L’article 10-1 de la loi de 1965 permet ainsi de condamner aux dépens le copropriétaire qui aurait engagé une procédure abusive ou dilatoire contre le syndicat. Réciproquement, le syndic qui ne respecterait pas ses obligations légales peut voir sa responsabilité engagée.
La Commission Départementale de Conciliation (CDC) offre un cadre institutionnel de médiation spécialisé en matière de copropriété. Composée paritairement de représentants des bailleurs, des locataires et des copropriétaires, elle peut être saisie gratuitement pour tenter de résoudre divers litiges, notamment ceux relatifs aux charges ou à l’application du règlement.
- Privilégier les démarches amiables préalables
- Documenter précisément les faits litigieux
- Respecter les délais de recours
- Évaluer le rapport coût/bénéfice d’une procédure judiciaire
- Consulter un avocat spécialisé en droit immobilier
La résolution efficace des conflits en copropriété nécessite une approche graduée, combinant diplomatie et fermeté juridique. Elle suppose une connaissance précise de ses droits et un sens stratégique dans leur défense, pour éviter l’escalade tout en préservant ses intérêts légitimes.
Évolutions et perspectives du droit de la copropriété
Le droit de la copropriété connaît des transformations significatives sous l’effet des évolutions sociétales, technologiques et environnementales. Ces mutations redéfinissent progressivement l’équilibre entre droits individuels et impératifs collectifs, dessinant les contours d’un régime juridique en constante adaptation.
Transition énergétique et rénovation des immeubles
La rénovation énergétique des bâtiments s’impose désormais comme un enjeu majeur pour les copropriétés. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a introduit des dispositions contraignantes, notamment l’interdiction progressive de location des logements considérés comme des « passoires thermiques ». Cette évolution législative affecte directement les droits des copropriétaires, en particulier leur capacité à louer librement leur bien sans réalisation préalable de travaux d’amélioration énergétique.
Le plan pluriannuel de travaux, rendu obligatoire par l’article 171 de la loi Climat et Résilience pour les copropriétés de plus de 15 ans, modifie substantiellement la gouvernance des immeubles. Ce document, établi pour une période de dix ans, doit être actualisé tous les cinq ans et voté en assemblée générale. Il contraint les copropriétaires à une vision prospective des travaux nécessaires, limitant ainsi leur liberté de décision ponctuelle.
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) collectif, progressivement généralisé, transforme l’approche traditionnelle de l’évaluation immobilière. La valeur patrimoniale des lots se trouve désormais étroitement liée à la performance énergétique globale de l’immeuble, créant une interdépendance accrue entre copropriétaires.
Les mécanismes de financement des travaux énergétiques évoluent également, avec le développement du tiers-financement et des prêts collectifs. Ces innovations juridiques et financières permettent de surmonter l’obstacle du coût initial des rénovations, mais complexifient les rapports juridiques au sein de la copropriété en introduisant des créanciers collectifs.
Digitalisation et nouvelles technologies
La dématérialisation des procédures modifie profondément les modalités d’exercice des droits des copropriétaires. La tenue d’assemblées générales par visioconférence, consacrée par l’ordonnance du 20 mai 2020 puis pérennisée, facilite la participation mais soulève des questions inédites sur l’authentification des votants ou la sécurisation des votes.
L’obligation de mettre en place un extranet de copropriété pour les immeubles de plus de 15 lots, imposée par la loi ELAN, transforme l’accès à l’information. Cette plateforme numérique doit permettre l’accès en temps réel aux documents de la copropriété (règlement, procès-verbaux, contrats, etc.), renforçant ainsi la transparence mais soulevant des enjeux de protection des données personnelles.
Les compteurs intelligents et la gestion technique centralisée des immeubles introduisent une dimension numérique dans la gestion quotidienne des parties communes. Ces technologies permettent une optimisation des consommations énergétiques et une détection précoce des dysfonctionnements, mais posent la question du contrôle des données générées et de la responsabilité en cas de défaillance.
La blockchain commence à être explorée comme outil de sécurisation des votes en assemblée ou de certification des décisions. Cette technologie pourrait, à terme, révolutionner la gouvernance des copropriétés en garantissant l’intégrité des procédures décisionnelles et en facilitant l’exécution automatique de certaines décisions via des « smart contracts ».
Évolutions sociologiques et nouveaux usages
Le développement de l’économie du partage impacte directement le régime de la copropriété. La multiplication des locations de courte durée via des plateformes comme Airbnb a conduit à des adaptations jurisprudentielles et législatives. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juin 2021, a ainsi précisé les conditions dans lesquelles un règlement de copropriété peut valablement restreindre la location touristique.
L’émergence des espaces partagés dans les immeubles récents (coworking, conciergeries, jardins partagés) modifie la conception traditionnelle des parties communes. Ces espaces hybrides, ni totalement privatifs ni totalement communs, nécessitent des adaptations du cadre juridique classique de la copropriété, notamment en termes de gestion et de responsabilité.
La mobilité résidentielle accrue des propriétaires transforme la sociologie des assemblées générales. La présence croissante d’investisseurs non-occupants, parfois étrangers ou institutionnels, modifie les dynamiques décisionnelles traditionnelles, privilégiant parfois la rentabilité à court terme sur la valorisation patrimoniale à long terme.
Les évolutions démographiques, notamment le vieillissement de la population, suscitent de nouveaux besoins d’adaptation des immeubles (accessibilité, services à la personne). Ces transformations nécessaires se heurtent parfois aux règles de majorité exigeantes pour les modifications d’usage ou d’aspect des parties communes.
- Adaptation nécessaire aux impératifs écologiques
- Intégration des technologies numériques dans la gouvernance
- Prise en compte des nouveaux usages résidentiels
- Équilibre entre protection patrimoniale et innovation
- Simplification des processus décisionnels pour faciliter l’adaptation
Ces évolutions dessinent progressivement un droit de la copropriété plus complexe mais aussi plus adaptable, où la dimension collective prend une importance croissante face aux enjeux contemporains. Le défi majeur consiste à préserver l’équilibre fondamental entre droits individuels et nécessités collectives, tout en facilitant l’adaptation des immeubles aux exigences de notre temps.
